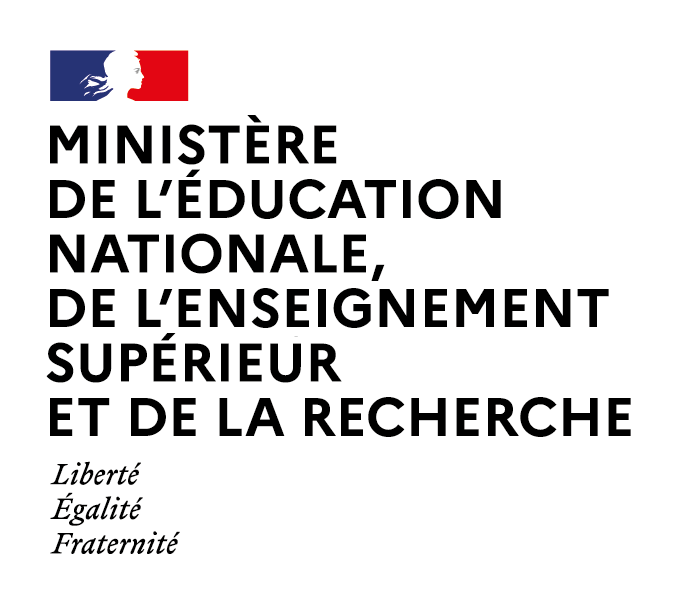Le 29 avril 1945, les Françaises votent
À l’occasion du 80e anniversaire de la première participation des femmes françaises à un scrutin électoral, cette page propose une mise au point et des ressources documentaires et pédagogiques, pour aborder en classe cet évènement historique, jalon de la République et témoin de la progression des droits des femmes.
Mis à jour : avril 2025
Mise au point historique et ressources documentaires
Un long combat et des oppositions persistantes
Les femmes françaises ont longtemps été privées de droits politiques, pourtant réclamés dès la Révolution française par la voix de Condorcet ou d’Olympe de Gouges. Ce combat est poursuivi et amplifié tout au long du XIXe siècle, lors des épisodes révolutionnaires d’abord, puis au travers de mouvements féministes suffragistes. Alors que les femmes commencent à obtenir le droit de vote et d’éligibilité dans certains pays (1893 en Nouvelle-Zélande, 1907 en Finlande), et que la Première Guerre mondiale joue un rôle d’accélérateur (octroi du droit de vote au Royaume-Uni et en Allemagne, entre autres, en 1918), les parlementaires français - notamment les sénateurs - continuent de s’y opposer, en dépit de plusieurs propositions de loi en ce sens dans l’entre-deux-guerres.
- Anne-Laure Briatte , « Le droit de vote des femmes », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe, 22 juin 2020.
- Grandes étapes de la conquête du droit de vote des femmes, vie-publique.fr, 4 juillet 2022.
- François Dubasque, « Les débats parlementaires sur le suffrage féminin dans l’entre-deux-guerres, un reflet de la peur des femmes en politique », in Frédéric Chauvaud (dir.), L’ennemi intime, PUR, 2011.
L’octroi du droit de vote en 1944
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des partis politiques (à l’exception des radicaux-socialistes) considèrent que les femmes doivent pouvoir voter et être éligibles.
Dès 1942, le général de Gaulle, chef de la France libre, déclare : « Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays ». Le 24 mars 1944, l’Assemblée consultative provisoire d’Alger, qui comprend deux femmes (Marthe Simard et Lucie Aubrac), adopte l’amendement Fernand Grenier qui instaure le droit de vote et d’éligibilité pour toutes les femmes françaises.
Le 21 avril 1944, l’ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération dispose, dès son premier article, qu’une assemblée nationale constituante sera élue par « tous les Français et les Françaises ». Son article 17 précise que, pour toutes les élections, « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes » (article 17).
Outre-mer, l’application de l’ordonnance du 21 avril est précisée par une ordonnance du 20 novembre 1944 (pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion) et un décret du 19 février 1945 (pour la Guyane). En Algérie française, alors que les hommes musulmans obtiennent le droit de vote par l’ordonnance du 7 mars 1944, il faut attendre la loi du 20 septembre 1947 pour que ce droit soit accordé en principe aux musulmanes : la loi prévoit qu’une décision de l’Assemblée algérienne doit fixer les modalités de l’exercice de ce droit, décision qui n’a jamais été prise.
- Le Sénat revient sur le contexte et les ultimes débats au moment de l’extension des droits politiques aux femmes.
- Anne-Sarah Bouglé-Moalic, « En 1944, l'obtention du droit de vote des femmes est presque une formalité », info.gouv.fr, 21 avril 2023.
Les premiers scrutins
Les premières élections auxquelles les femmes participent sont les municipales d’avril-mai 1945. Après 9 années sans scrutin général direct (les dernières élections municipales ont eu lieu en mai 1935, les dernières législatives en 1936), les Français retournent aux urnes le 29 avril 1945 pour élire les conseils municipaux. Les combats ne sont pas encore terminés sur l’ensemble du territoire, et certaines élections auront lieu plus tardivement (Alsace, Moselle, Belfort, poches de l’Atlantique).
Dans un temps de refondation de la République, les scrutins s’enchaînent : élections cantonales en septembre 1945, constituantes en octobre 1945, nouvelles élections constituantes en juin 1946 après le rejet par référendum du premier projet de Constitution (5 mai 1946).
La première participation des femmes est l’objet d’un regard attentif des contemporains, journalistes notamment, et a été étudiée depuis par les politistes sur la plus longue durée. Leur participation aux municipales de 1945 semble équivalente à celle des hommes, mais va par la suite diminuer. Pour l’historienne Yannick Ripa, « le suffrage devenu réellement universel ne bouleverse ni le paysage politique français ni la vie des femmes. »
Surtout, après une timide percée au lendemain de la guerre, les femmes demeurent, en dépit de leur éligibilité, sous-représentées parmi les élus. C’est ce que l’instauration de la parité à la fin du XXe siècle cherche à modifier.
- Janine Mossuz-Lavau, « Le vote des femmes en France (1945-1993) », Revue française de science politique, 1993, 43-4, p. 673-689.
- France Culture met à disposition un épisode de 1993, tiré de l’émission « La France en direct » : « 29 avril 1945 : le premier vote des femmes ».
Liens avec les programmes
Histoire
En histoire, l’obtention du droit de vote des femmes peut être abordée dès le CM2 (Le temps de la République), et apparaît explicitement en classe de 3e : dans le cadre du chapitre intitulé « Françaises et Français dans une République repensée », le programme précise qu’au lendemain de la guerre, dans une dynamique de refondation, « la République intègre politiquement les femmes ».
En classe de 1re générale, l’étude de la IIIe République peut conduire à mettre en avant le « refus du droit de vote des femmes ». En terminale technologique, le thème consacré à « La France de 1945 à nos jours : une démocratie » amène à traiter des évolutions du modèle républicain à la Libération, notamment les réformes politiques.
En classe de CAP, le thème consacré à « La France de la Révolution française à la Ve République : l'affirmation démocratique » comporte parmi les repères à acquérir « 1944 : droit de vote des femmes ». En terminale professionnelle, le thème « Vivre en France en démocratie depuis 1945 » convoque ce même repère.
Enseignement moral et civique
En EMC, la question de l’égalité femmes-hommes est abordée en classes de 5e et de 1re, ainsi que dans les classes préparant au CAP. En classe de 5e notamment, le programme rappelle que « l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de la République », et invite à montrer, par exemple à travers le cas du droit de vote, que cette égalité est « le résultat de combats ».
Ressources pédagogiques
Le site L’histoire par l’image propose une étude sur « le premier vote des femmes en France ».
Lumni Enseignement propose plusieurs ressources :
- Un reportage des actualités françaises de 1945 : « Les femmes votent pour la première fois en France en 1945 »
- Un épisode de la série « La Grande explication » : « Le droit de vote des femmes »
- Une vidéo de réseau Canopé de la collection « Les années De Gaulle » répond à la question « Pourquoi les femmes françaises n’obtiennent le droit de vote qu’en 1944 ? »
Le Musée de la Résistance en ligne propose une archive de presse : un article paru dans Le Provençal, le 30 avril 1945, intitulé « Comment elles ont voté ».
La fondation Charles de Gaulle propose un dossier thématique regroupant documents, analyses et témoignages sur le droit de vote des femmes.