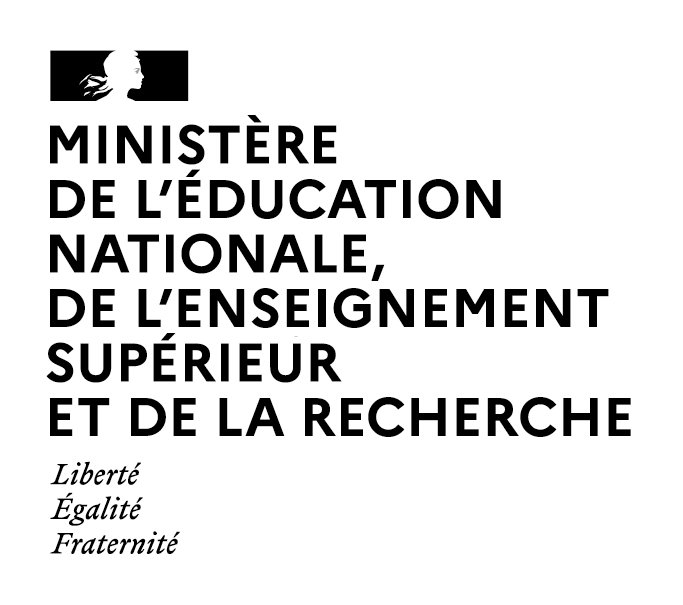Veille éducation numérique 2024-2025
Veille éducation numérique est un bulletin de veille informationnelle sur le numérique éducatif. Les articles traitent des enjeux liés aux technologies numériques (intelligence artificielle, traçabilité numérique, handicap et numérique…), aux choix des ressources et à leurs usages dans le cadre des apprentissages scolaires.
Mis à jour : avril 2025
Avril 2025
GeoImage
La recherche d’information satellitaire
Les images des satellites constituent aujourd’hui un outil essentiel dans de nombreux champs d’application, qu’ils relèvent de la recherche scientifique, de l’enseignement ou de la diffusion auprès du grand public. Dans une perspective de valorisation de leur usage pédagogique et de développement de la culture de l’image spatiale, le centre national d’études spatiales (CNES), en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) a mis en place le projet GeoImage.
Ce dispositif, dans sa nouvelle version, offre aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs un accès à des images issues des satellites Pléiades, Spot et Sentinel. Chaque image est accompagnée d’un dossier d’analyse scientifique élaboré avec le concours d’experts issus des sphères de l’enseignement secondaire et supérieur. Ces dossiers permettent une lecture approfondie des territoires et de leurs dynamiques, en combinant une vue générale et des zooms thématiques facilitant l’interprétation des phénomènes géographiques. Le site répond ainsi aux besoins des enseignants, des universitaires et des chercheurs et de toute personne intéressée par les données issues de l’observation satellitaire.
Sources
- GeoImage :https://cnes.fr/geoimage
- Dossiers par programmes scolaires : https://cnes.fr/geoimage/dossiers-programmes-scolaires
- Dossiers thématiques : https://cnes.fr/geoimage/dossiers-thematiques
- Édubase : sélection de scénarios pédagogiques ayant recours à GeoImage
Réseaux et médias sociaux
Les infox de l’Histoire
Audios pour décrypter les mensonges à travers les siècles
« Les Infox de l'Histoire » est un podcast animé par Patrice Gélinet, en partenariat avec franceinfo et la Fondation Descartes. Ce programme audio explore les grandes affaires de désinformation qui ont marqué l'histoire, en analysant des cas de complotisme, de manipulations, de rumeurs et de calomnies, de l’incendie de Rome jusqu'à l’assaut du Capitole. Chaque saison, au nombre de trois, comprend huit épisodes, chacun (d’une durée de 20 à 25 minutes) dédié à une affaire spécifique de désinformation historique. Par exemple, le tout dernier épisode diffusé en mai 2024, s'intitule « Une histoire instrumentalisée : l’Ukraine » et aborde la manière dont l'histoire ukrainienne a été utilisée à des fins de propagande.
Sources
Réseaux et médias sociaux
Mars 2025
Automation et intelligence artificielle
Un glossaire transdisciplinaire critique
L'édition de mars 2025 de la Lettre ÉduNum Thématique s'appuie sur un glossaire pédagogique transdisciplinaire critique mettant en lumière dix notions clés pour comprendre les « automates computationnels » et les défis qu'ils posent.
L'introduction s’ancrant dans les propos d’Anne Alombert déconstruit les termes intelligence artificielle et apprentissage automatique en rappelant qu'il s'agit avant tout d'opérations mathématiques appliquées à d'immenses volumes de données. La philosophe préconise d'utiliser les termes processus d'automatisation ou automates computationnels interactifs pour désigner ces systèmes.
En outre, la lettre souligne les mises en garde émises contre la confusion entre mémoire humaine et mémoire machinique, cette dernière n'étant qu'un simple stockage numérique révisable, comme le rappelle Giuseppe Longo. David Bates et Bernard Stiegler en particulier insistent sur les risques de dégénérescence cognitive associés à l'usage de l'IA, tout en envisageant des pistes pour en faire un levier d'intelligence collective. Parmi les thèmes abordés dans cette édition, plusieurs notions sont développées, complétées par des ressources multimédias (articles, vidéos, podcasts, illustrations) : agentivité, algorithme, apprentissage automatique, coltan, confabulation, réseau de neurones, confiance, frugalité, etc.
Sources
Réseaux et médias sociaux
Concepts clefs pour décoder l’intelligence artificielle
Conférence de Jean-Gabriel Ganascia
Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique et philosophe, présente un court exposé sur la notion d’IA en revenant en préambule sur la capacité à connaître et les fonctions cognitives pour inscrire l’intelligence dans l’intelligence artificielle. Il rappelle notamment les tentatives passées de simulation du raisonnement par des machines : la machine arithmétique de Leibniz, la machine analytique de Babbage et Lovelace, le piano logique de Jevons ou encore l’automate électromécanique de Torres y Quevedo. L’auteur cite en outre deux articles centraux traitant pour le premier des « machines téléologiques » (Wiener, Bigelow et Rosenblueth) et le second des « neurones formels » (McCulloch et Pitts). Il évoque les balbutiements de la traduction automatique et dresse un bref historique de l’IA (premiers programmes, prophéties, « hivers », systèmes experts) en commençant par l’introduction officielle de l’expression d’intelligence artificielle en 1956. Il souligne par la suite les travaux de Yann Le Cun et l’importance des réseaux de neurones profonds dans le développement des IA dites génératives et des grands modèles de langage, en prenant toutefois le soin d’alerter l’auditoire sur la nécessaire prudence à adopter vis-à-vis des résultats générés.
Sources
- Jean-Gabriel Ganascia. « Mais où va l'IA ? ». Exposé au sein de la conférence Décoder l'IA en 2025 : actualités d'une technologie en voie de banalisation
- Centre de culture numérique (CCN) : Université de Strasbourg (captation vidéo intégrale de la journée)
Réseaux et médias sociaux
Jean-Gabriel Ganascia : https://x.com/Quecalcoatle
Utopies, contre-utopies et dystopies numériques
Cours de culture numérique d’Hervé Le Crosnier
Hervé Le Crosnier revient aux « sources de l’utopie numérique » des débuts d’Internet et du Web reposant sur des principes d’égalité d’accès à l’information, de coopération décentralisée et de liberté d’expression, en évoquant notamment la figure mythique de Stewart Brand, créateur du Whole Earth Catalog arborant la « bille bleue » en couverture, la démonstration révolutionnaire réalisée par Douglas Engelbart en 1968, The Mother of All Demos et ses innovations multiples (la souris 🖱️, l'interface graphique, l'hypertexte, l'édition de texte en temps réel avec curseur et copier-coller, le travail collaboratif en réseau, la visioconférence et le partage d’écran), la Déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow en 1996 ou encore le mouvement du logiciel libre initié par Richard Stallman.
L’auteur évoque les évolutions des technologies numériques et différents concepts comme la destruction créatrice schumpétérienne, la création destructrice (robots-soldats), la disruption opérée à travers la plateformisation (effets de réseau, rente technologique, dépendance et précarisation, management invisible, désagrégation sociale et dissensus), les communautés virtuelles (par exemple, la propagande computationnelle du Parti des 50 centimes), le commun Wikipédia, l’intelligence artificielle ubiquitaire, l’information stéréotypée, la cybersécurité et la surveillance algorithmique, la délégation machinique de responsabilité, etc.
Sans ignorer les aspects liés à la captologie (économie de l’attention, circuit dopaminergique) et les phénomènes de cyberviolence, le conférencier réfute toutefois l’idée d’abêtissement digital et écranique. Développer la culture numérique permet de garantir que la démocratie va perdurer dans le monde numérique : il s’agit d’élargir l’autonomie des individus, d’être capable d’habiter ledit écosystème, d’apprécier à leur juste valeur les formes culturelles produites par ces technologies, d’affronter les mainmises et les formes de domination (traçage, vectorialisme, industrie de l’influence). La culture numérique est un élément essentiel de la culture générale du XXIe siècle, vectrice, selon Hervé Le Crosnier, d’une citoyenneté démocratique à reconstruire.
Sources
- Hervé Le Crosnier. CEMU. (2024, 3 décembre). 24-25 Cours de culture numérique | Comment en est-on arrivé là ?, in Cours de Culture numérique 2024-2025. [Vidéo]. Canal-U. https://doi.org/10.60527/2e3s-xc37. (Consultée le 5 mars 2025)
Réseaux et médias sociaux
- Hervé Le Crosnier sur Linkedin
Technologies numériques, droit et justice
IA générative, identité numérique, jetons non fongibles
Une publication de l’Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice (IERDJ) s’interroge sur les applications d’automation textuelle en matière judiciaire, l’identité et l’identification numériques, ainsi que l’exemple des biens numériques tels que les NFT. Au-delà du périmètre spécifique imposé les contributions expertes soulignent les différents enjeux éthiques liés aux tensions entre innovation technologique et respect d’un certain nombre de principes fondamentaux : fiabilité et transparence des décisions automatisées, biais algorithmiques et discrimination, responsabilité juridique, déshumanisation, protection des données personnelles, traçabilité, marchandisation, impact environnemental. L’un des constats mis en avant stipule par exemple qu’« il est à ce jour nécessaire de déconstruire un narratif commercial visant à parler de capacités de réflexion similaires aux capacités humaines dans les modèles de langage ». Les auteurs soulignent par ailleurs un possible phénomène de « persuasion latente » ou de décoloration sur les utilisateurs lors d’activités de coécriture assistée par un GML, sans ignorer les perspectives nouvelles d’allègement de la charge de travail. Ces thématiques ont leur place dans les apprentissages abordant la vie démocratique (EMC), l’Internet, le Web et les pratiques humaines (SNT), le droit et les grands enjeux du monde contemporain (DGEMC).
Sources
Réseaux et médias sociaux
Février 2025
Apprendre les langues aux machines
Leçon inaugurale prononcée au Collège de France le jeudi 30 novembre 2023
L'ouvrage intitulé Apprendre les langues aux machines est la leçon inaugurale prononcée par Benoît Sagot au Collège de France le 30 novembre 2023. Polytechnicien et docteur en informatique, l’auteur, invité sur la chaire annuelle Informatique et sciences numériques, y explore l'évolution du traitement automatique des langues (TAL), discipline au carrefour de la linguistique et de l'informatique. Il en retrace les étapes clés, des approches symboliques aux méthodes neuronales actuelles, en passant par l'apprentissage automatique. L'auteur analyse également les défis éthiques et sociétaux posés par les avancées récentes, notamment avec l'émergence de modèles conversationnels tels que ChatGPT. Cette leçon offre une perspective éclairante sur les enjeux actuels du TAL et son impact sur notre rapport aux langues et à l'information.
Sources
- Publication numérique de la leçon inaugurale prononcée par Benoît Sagot au Collège de France
- Captations audiovisuelles de la chaire
Réseaux et médias sociaux
La « Semaine des médias » à l'école en Suisse romande
Informer sans déformer
En 2025, environ 58 activités pédagogiques sont proposées aux classes de Suisse romande, sur le thème « Informer sans déformer » dans le cadre de la « Semaine des médias » (10 au 14 février 2025). Elles sont calibrées « pour impliquer des élèves de tous âges et être menées de manière autonome par le corps enseignant ». En complément, une série de 10 capsules vidéos permettent de s’interroger sur « l’univers fascinant des médias à l’heure de l’urgence climatique ».
Sources
- Semaine des médias 2025 : 10 épisodes vidéos sur l'impact environnemental de nos usages numériques, l'impact environnemental d'un smartphone, écologie et fake news, l'impact des médias sur la perception de l'écologie, etc.
- Dossier pédagogique Les médias et l’environnement (fichier PDF, 30 p.)
- Activités pédagogiques
- Présentation de la Semaine des médias
Réseaux et médias sociaux
- CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin) sur LinkedIn
Janvier 2025
Art contemporain et médias numériques
Entretien avec Pascal Dombis
Le cours en ligne (MOOC) intitulé Art contemporain et médias numériques est consacré à Pascal Dombis, artiste visuel né en 1965, dont le travail explore l’excès et le hasard à travers son usage des machines et des algorithmes. Ses œuvres ont été exposées internationalement, notamment à Paris, São Paulo, Bruxelles, Venise, Londres, Shanghai et Bangkok. Le cours se décompose en plusieurs modules vidéo où Pascal Dombis partage son parcours artistique et ses influences. Il évoque sa transition de la peinture traditionnelle vers les outils numériques, influencé par des artistes tels que Mondrian, Pollock, Rothko, Frank Stella et Sol LeWitt, ainsi que par la littérature américaine, notamment la technique du cut-up.
L’artiste détaille également son processus créatif, décrivant comment ses idées émergent et se transforment en œuvres d'art. Il met l'accent sur le numérique, le lenticulaire et les bases de données dans sa pratique, tout en partageant ses réflexions sur le rôle de la main de l'artiste dans l'histoire de l'art. Le MOOC aborde aussi les projets in situ de l’auteur, réalisés dans des villes comme Paris et Bangkok, offrant un aperçu de son approche des commandes publiques et de l'organisation de ses expositions personnelles. Enfin, il partage des aspects de sa vie d'artiste, incluant ses relations avec les galeries, les collectionneurs, et son utilisation des réseaux sociaux pour diffuser son travail. Ce cours s'inscrit dans le cadre du MOOC Digital Paris, plateforme de formation aux cultures et pratiques numériques, coordonnée par Dominique Moulon.
Sources
Réseaux et médias sociaux
Médias synthétiques
Les interactions entre l‘intelligence artificielle et les médias
Le dossier « IA et médias » du Quai des Savoirs toulousain explore l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur la production, la diffusion et la consommation de l'information. Il met en lumière le traitement algorithmique des données et la personnalisation des contenus, tout en soulevant des préoccupations concernant la qualité et la diversité de l'information. La propagation rapide des fausses nouvelles est également abordée, interrogeant la responsabilité des plateformes numériques et des médias traditionnels.
Le dossier propose, entre autres, une sélection de contenus pour approfondir ces thématiques :
- Tribunal de l’IA : le public a délibéré ! Un événement où l'intelligence artificielle a été mise en procès, avec témoignages et expertises, visant à éveiller l'esprit critique des participants.
- Comment lutter contre la désinformation à l’ère de l’intelligence artificielle ? Une interview de Thomas Huchon présentant une application développée pour combattre les fake news sur les réseaux sociaux, particulièrement en période électorale.
- ChatGPT est-il plus malin que nous ? Un podcast explorant les capacités et les limites de l’artefact génératif.
- L’artificialisation en direct. Un article sur l'artiste Alain Josseau, qui, en collaboration avec des experts, crée une installation robotisée simulant un journal télévisé et soulignant l’automatisation de l’information.
Sources
Réseaux et médias sociaux
Anthropologie des cultures numériques et des changements environnementaux
Les travaux du chercheur Nicolas Nova
Nicolas Nova, anthropologue et chercheur en design, subitement disparu le 31 décembre 2024, est reconnu pour ses travaux sur les interactions entre le numérique et les cultures contemporaines. Professeur à la Haute école d'art et de design de Genève, il est également co-fondateur du Near Future Laboratory, studio de design explorant les implications des technologies émergentes.
Parmi ses publications accessibles en ligne, son ouvrage Smartphones : une enquête anthropologique (issu de sa thèse Figures mobiles : une anthropologie du smartphone) examine l'impact des téléphones portables sur la vie quotidienne, en s'appuyant sur des études de terrain menées à Genève, Los Angeles et Tokyo. Nicolas Nova a également publié de nombreux écrits sur la création en design, la géolocalisation, la réparation des objets numériques (rebuts numériques) ou la « tératologie machinique ».
Sources
- Nicolas Nova : https://orcid.org/0000-0001-9835-5237
- Bibliographie : HAL
Réseaux et médias sociaux
- Nicolas Nova : https://x.com/nicolasnova
Limites numériques
Recherche entre design et informatique sur l’empreinte environnementale du numérique
Selon l’à propos du site, Limites Numériques aborde la problématique de l’impact écologique du numérique par les usages et le design des services numériques et interactifs. Les auteurs s’intéressent également « aux formes graphiques, aux fonctions, aux interactions et aux usages mais aussi aux milieux techniques qui influent directement ou indirectement sur l’obsolescence des terminaux ». Ils préconisent en outre un numérique contraint par les limites planétaires et analysent comment cette démarche active transforme les pratiques de travail et de conception.
Sauf mention contraire, le design de ce site et ses contenus sont placés sous licence Creative Commons BY-SA 3.0 permettant de partager et adapter les documents sous les conditions suivantes : attribuer la paternité à Limites Numériques et republier sous les mêmes conditions de licence.
Sources
- Limites numériques : https://limitesnumeriques.fr
- Travaux et productions : https://limitesnumeriques.fr/travaux-productions
Réseaux et médias sociaux
- Nolwenn Maudet : https://mastodon.design/@nolwennm
- Aurélien Tabard : https://hci.social/@aurelien
- Thomas Thibault : https://mastodon.design/@thomasthibault
- Anaëlle Beignon : https://mastodon.design/@anaellebeignon
Décembre 2024
Parcours pédagogique précinéma
Découverte des objets optiques préfigurant le domitor
UPOPI, université populaire des images, conçue par les équipes pédagogiques de Ciclic, agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique, offre des parcours de sensibilisation aux images à mener en cinq à dix séances de 45 minutes à une heure, avec des enfants de trois à dix ans. Neuf séances sont ainsi consacrées aux découvertes antérieures au kinétoscope et au cinématographe.
- Séance 1 - Le thaumatrope
- Séance 2 - Le phénakistiscope
- Séance 3 - Le zootrope
- Séance 4 - Le folioscope
- Séance 5 - Le praxinoscope
- Séance 6 - La chambre noire
- Séance 7 - La photographie
- Séance 8 - La lanterne magique
- Séance 9 - La chronophotographie
Une frise chronologique intitulée Qui a inventé le cinéma ? complète ce parcours « magique ».
Sources
Réseaux et médias sociaux
- Facebook : https://www.facebook.com/Ciclic.RegionCentre
Angles morts du numérique ubiquitaire
Glossaire critique : définitions, courts essais et synthèses pédagogiques
Le numérique, omniprésent, s'infiltre partout : il connecte, assiste, augmente, et surveille. Pourtant, cette ubiquité selon les auteurs du glossaire Angles morts du numérique ubiquitaire s'accompagne de zones d'ombre où des réalités échappent à la logique dominante du numérique. Ces espaces, où ce qui compte reste souvent invisible, révèlent à la fois les limites des technologies actuelles et des lacunes dans leur conception. Mais ils incarnent aussi des marges précieuses d’opacité, essentielles pour préserver certaines libertés.
L’ouvrage, structuré autour de 145 entrées, explore ces ambivalences. Il présente des concepts familiers ou surprenants, des analyses critiques et des synthèses pédagogiques pour mieux comprendre les implications de la programmation ubiquitaire. À travers ce vocabulaire, il invite à repenser un usage du numérique qui, malgré ses dérives inquiétantes, continue de porter des promesses d’émancipation et d’intelligence collective.
Le texte seul est utilisable sous licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Sources
- Citton, Y., Lechner, M., & Masure, A. (éds.). (2023). Angles morts du numérique ubiquitaire. Presses universitaires de Paris Nanterre. https://books.openedition.org/pupo/36364?format=toc
Réseaux et médias sociaux
X : @OpenEditionActu
Une anthologie d’essais sur des sujets de recherche actuels
Sélection de contributions thématiques en accès libre et gratuit
Les Living Books about History sont des anthologies numériques qui explorent des sujets de recherche contemporains. Chaque ouvrage contient un résumé introductif, accompagné de textes, images, vidéos ou autres ressources, principalement accessibles en ligne gratuitement. Inspiré du projet Living Books about Life, le projet adopte une approche innovante pluridisciplinaire et multilingue en liant des ressources avec des hyperliens pour revitaliser le concept d’anthologie.
Les Living Books about History couvrent une grande variété de thèmes liés à l'histoire et aux sciences humaines. Parmi les sujets traités, on retrouve notamment Femmes, genre et informatique, histoire de la place des femmes dans l'informatique depuis les années 1940, mettant en lumière les dynamiques de masculinisation et de pratiques genrées, Pour une histoire élargie de la télévision, étude des fondements et historiographies de la télévision en tant qu'objet académique, Histoires de l’Internet et du Web, à travers une sélection de sources et de textes sur les acteurs, méthodologies et trajectoires de l’informatique et du numérique, ou encore Humanités numériques, introduction en anglais à ce domaine, avec une réflexion sur son histoire, ses pratiques et ses définitions.
Sources
- Living Books about History : https://www.livingbooksabouthistory.ch/fr
Réseaux et médias sociaux
- X : @infoclio
Novembre 2024
Un dépôt d’images d’IA sous licence Creative Commons
Représentations alternatives de l’intelligence artificielle
Le projet Better Images of AI a été lancé pour nuancer la représentation visuelle de l’intelligence artificielle dans les médias et les publications. Actuellement, les images associées à l’IA sont dominées par des clichés comme les cerveaux lumineux, les robots futuristes ou les circuits électroniques, des symboles qui véhiculent des idées erronées et stéréotypées. Ce projet vise ainsi à produire des images plus réalistes et inclusives pour mieux refléter l’IA et ses impacts sociaux. Une bibliothèque gratuite d'images sous licence Creative Commons a été créée pour aider les chercheurs, journalistes et créateurs de contenu à adopter ces nouvelles représentations. Ces images couvrent des thématiques comme les travailleurs humains impliqués dans l’apprentissage des systèmes ou les applications concrètes de l’IA dans des domaines variés. L’objectif est de promouvoir des visuels informatifs et responsables. Le projet invite en outre les artistes et organisations intéressés à y contribuer pour enrichir son contenu, notamment en intégrant des perspectives sous-représentées.
Sources
- Better images of AI : https://betterimagesofai.org
- Bibliothèque : https://betterimagesofai.org/images
Réseaux et médias sociaux
- X : @ImagesofAI
- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/better-images-of-ai
Un annuaire d’ouvrages académiques en accès libre et gratuit
Portraits de femmes scientifiques en trois tomes distincts
Le site Pressbooks Directory répertorie des ouvrages libres d'accès produits avec la plateforme Pressbooks, couvrant divers domaines académiques. Accessible en plusieurs langues, dont le français, ce répertoire permet de découvrir des manuels et ressources éducatives en consultation libre ou sous licence Creative Commons. Plus de 200 livres en langue française sont actuellement disponibles, parmi lesquels on pourra recenser une « série de portraits de femmes qui ont contribué de manière significative au patrimoine scientifique de l’humanité dans toutes les sciences » (tomes 1, 2 et 3) : Rose Dieng-Kuntz, Ada Lovelace, Elinor Ostrom, Hannah Arendt, Rosalind Franklin, etc.
Sources
- Pressbooks Directory : https://pressbooks.directory/?lang=French&p=4
- Éditions science et bien commun (collection Femmes de science) : https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/catalog/flopir08
Réseaux et médias sociaux
Intelligence artificielle - Le dessous des images
Huit épisodes du magazine d’Arte
L'émission Le dessous des images sur Arte a consacré plusieurs épisodes à l'analyse de l'impact de l'intelligence artificielle sur la création et la perception des images :
- L'œuvre et l'intelligence artificielle examine une toile ayant remporté un premier prix à la Foire d'État du Colorado en août 2022. Intitulée Théâtre d'opéra spatial, cette œuvre a été créée à l'aide de l’IA. L'émission analyse les enjeux entourant cette création en compagnie de son auteur, Jason Allen, et de l'historien de l'art Paul Ardenne.
- L'IA, mon avatar et moi explore l'application Lensa AI, qui permet de créer des avatars personnalisés. Téléchargée plus de 20 millions de fois, elle suscite autant d'engouement que de questions, notamment sur les stéréotypes et les représentations générées par IA.
- IA : le vertige des robots humanoïdes s'interroge sur la tendance à donner un visage humain à l'IA, en particulier à travers la première conférence de presse menée par des robots humanoïdes, marquant un tournant symbolique dans notre rapport à la technologie.
- IA : Sora, la fabrique du faux réel analyse une vidéo ultra-réaliste d'une balade à Tokyo, entièrement générée artificiellement, floutant ainsi la frontière entre réel et virtuel.
- L'IA, envoyée spéciale dans le passé : cet épisode présente des photographies historiques recréées par Midjourney, notamment des clichés de La Havane dans les années 1950, et s'interroge sur l'authenticité et l'éthique de telles reconstitutions.
- Et Dieu créa l'IA examine une illustration populaire de Pop Nukoonrat représentant l'IA, disponible sur l'agence Getty, qui convoque des références bibliques et un univers futuriste, révélant davantage sur nos perceptions que sur la réalité technique.
- L'épisode intitulé La fin du genre humain en 39 secondes analyse une vidéo d'animation qui revisite la fresque classique de l'évolution humaine. Cette séquence, réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part des opposants aux nouvelles technologies et des créationnistes. L'infographiste Fabio Comparelli, créateur de la vidéo, explique que sa démarche était purement artistique et non scientifique. L'historien des cultures visuelles André Gunthert replace cette œuvre dans le contexte des représentations de l'évolution, éclairant ainsi les raisons de son succès viral.
- L'épisode intitulé IA : le policier avait six doigts représente un CRS enlaçant une manifestante lors des mouvements sociaux contre la réforme des retraites en France. Publiée sur Twitter en février 2023, cette image a trompé de nombreux utilisateurs, suscitant un débat sur la diffusion de photos factices générées par des IA. L'auteur de l'image, Anthony, graphiste amateur, explique sa démarche et fournit des clés pour identifier les caractéristiques d'une image produite par IA. Le docteur en neurosciences Albert Moukheiber analyse les réactions du cerveau face à ces représentations trompeuses
Sources
- Le dessous des images : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-023176/le-dessous-des-images
- Documentaires Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-023353/intelligences-artificielles
- Lettre ÉduNum thématique no24 – Esthétiques de l'artificiel : https://eduscol.education.fr/document/61099/download
Réseaux et médias sociaux
- X : @ARTEfr, @gunthert, @Sonia_Devillers
Plateforme francophone de lutte contre la désinformation
Articles scientifiques, rapports, études et ressources pédagogiques
Le centre de ressources de l’ODIL, porté par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Check First, rassemble des contenus de formations, des contributions de la recherche francophone ainsi que des capsules vidéo courtes consacrées aux termes de la lutte contre les désordres de l’information. On pourra s’intéresser à certaines d’entre elles, notamment :
- Quelle est la différence entre désinformation, mésinformation et malinformation ?
- Qu’est-ce qu’un deepfake ?
- C’est quoi un troll ?
Sources
Réseaux et médias sociaux
- X : @ODILplateforme
Octobre 2024
L’art dans ma classe
Plateforme éducative des œuvres de la collection nationale du MNBAQ
L’art dans ma classe est un site éducatif, réalisé dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ) et conçu par le Musée national des beaux-arts du Québec en collaboration avec le Réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l’intégration des technologies (le RÉCIT), Virtu_Ose Éducation, l’École en réseau, les enseignants du Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries (CSDPS) ainsi que les enseignants du Centre de services scolaires des Navigateurs (CSSDN). Le Musée national des beaux-arts du Québec vise à promouvoir l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel.
La plateforme éducative regroupe un ensemble de contenus pédagogiques accessibles depuis les onglets de la page d’accueil :
- une cinquantaine d’activités pédagogiques (ateliers de création et d’écriture, activités de discussion, présentations orales, jeux) ;
- l’accès à plus de 60 œuvres de la collection nationale classées par niveaux, catégories, collections, artistes ;
- des ressources vidéo complémentaires (entrevues d’artistes, appréciations d’œuvres, capsules ludiques) ;
- un lexique.
Sources
- L’art dans ma classe : https://lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr
- Un exemple d’œuvre : Coq licorne de Jean Dallaire
Réseaux et médias sociaux
Le CyberDico de l’ANSSI
Mots, expressions et sigles du domaine de la cybersécurité
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié le 15 juillet 2024 son CyberDico, un lexique français/anglais de la cybersécurité. Pour chaque entrée il présente la traduction ainsi que la définition en français et en anglais au sein d’un tableau organisé de manière alphabétique. Ce document évolutif d’une trentaine de pages est téléchargeable gratuitement au format PDF. On y trouve des termes courants comme faille de sécurité, usurpation d’adresse ou veille.
Pour fournir un exemple complet la lexie « mot de passe » sera traduite en anglais par « password » puis définie en français comme « un élément de déverrouillage servant dans la vérification de l’identité annoncée d’une personne par un système d’information » et en anglais comme « an unlocking element used in the verification of a person's announced identity by an information system ».
Sources
- CyberDico : https://cyber.gouv.fr/publications/cyberdico-quest-ce-que-cest
- Scénarios pédagogiques sur la cybersécurité : Édubase
Réseaux et médias sociaux
- X : @ANSSI_FR
La désinformation : une approche interdisciplinaire
Deux numéros thématiques de la revue de recherche de l’Enssib
Cette nouvelle édition de la revue Balisages se compose d’un numéro double (n° 7 et 8) dédié aux défis de la désinformation « d’hier et d’aujourd'hui ». Elle est coordonnée par Stéphane Le Bras (historien à l’Université Clermont Auvergne), Djbril Diakhaté (de l’École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes [EBAD] au Sénégal) et Susan Kovacs (spécialiste des sciences de l’information et de la communication [SIC] à l’Enssib).
Le premier numéro décrypte les procédés (linguistiques, techniques, médiatiques) de propagation de la désinformation et vise particulièrement les acteurs, vecteurs ou cibles de cette forme d’infopollution. On pourra notamment consulter l’article sur La réinformation ou l’amplification socionumérique de la désinformation et les analyses portant sur le dessin de presse comme arme contre la désinformation. Le second volet s’intéresse aux contextes historiques et culturels des processus de désinformation : « il analyse le rôle des ‶contextes″ (sociaux, géo-historiques, techniques) dans la production et la circulation de la désinformation, et en particulier les contextes de tension (crise sanitaire, guerre, mouvement de libération) ou de recompositions politiques ».
Sources
- Balisages 7 : https://journals.openedition.org/balisages/954
- Balisages 8 : https://journals.openedition.org/balisages/1373
- Sélection de scénarios pédagogiques en académies : Édubase
Réseaux et médias sociaux
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/school/enssib
Septembre 2024
Les modules pédagogiques d’intelligence artificielle de Vittascience
Une plateforme qui rend accessible l’IA pour les élèves et les étudiants
L’interface propose plusieurs outils innovants permettant d'entraîner et d'expérimenter des modèles d'IA. Les utilisateurs peuvent travailler avec des images, des sons, des postures pour créer des modèles, tout en visualisant les zones d'interactions utilisées par le système pour prendre des décisions. Un module permet en outre d'explorer et de visualiser la structure et le fonctionnement des réseaux de neurones, facilitant ainsi une compréhension plus approfondie des processus internes.
Deux outils génératifs, images et textes, sont également mis à disposition des usagers, ce qui permet d’étudier la rédaction des instructions et la pertinence des réponses fournies. Vittascience est lauréate à deux reprises (2019, 2022) du dispositif Édu-up piloté par le ministère de l’Éducation nationale, qui soutient la production de ressources numériques innovantes et adaptées. Vittascience permet enfin, notamment au sein du GAR, des usages pédagogiques en conformité avec le RGPD.
Sources
Réseaux et médias sociaux
- X : @vittascience
La bande dessinée en ligne
Une collection du dépôt légal de la BnF
Dans le cadre du dépôt légal du web, la Bibliothèque nationale de France (BnF) donne accès à des archives qui remontent à 1996. Pour valoriser ces collections auprès du grand public et des chercheurs, des sélections thématiques éditorialisées sont réalisées. Ces parcours sont accessibles uniquement au sein des Archives de l’internet consultables dans les salles de recherche des différents sites de la BnF et dans les bibliothèques partenaires en région.
Des versions texte de ces parcours sont toutefois disponibles au format PDF sans les images ni la possibilité de naviguer dans les sites en question. Comme exemple, ce parcours offrant un panorama généraliste de la bande dessinée en ligne et de ses acteurs. Toute la diversité de la bande dessinée est présentée, de ses origines patrimoniales à l’influence des cultures étrangères, en passant par la pluralité des sujets traités et l’impact des technologies numériques avancées sur le neuvième art. Une version illustrée est aussi proposée.
Sources
- La bande dessinée en ligne : https://www.bnf.fr (version texte)
- La bande dessinée en ligne : https://www.bnf.fr (version illustrée)
- BnF : Parcours guidés
- Scénarios pédagogiques pour exploiter la bande dessinée : Édubase
Réseaux et médias sociaux
X : @BnF
Découvrir le riche patrimoine sportif français et international
Stadium, plateforme interactive du Musée National du Sport
Dans le cadre du plan héritage du Gouvernement français Stadium propose une vaste collection de documents, d'objets et de récits autour des grandes figures et événements du sport. En plus des expositions virtuelles, Stadium met en avant au sein de la rubrique Documents et objets des histoires inspirantes et des portraits de sportifs, des disciplines sportives (abécédaire, A comme Athlétisme, W comme Water-polo), soulignant l'impact du sport sur la culture et la société.
Le site encourage la participation du public à travers des appels à contributions pour enrichir ses archives. Des sections spécifiques sont dédiées à l'histoire des Jeux olympiques et à d'autres événements marquants. Le site facilite également la recherche dans les collections du musée (outil de recherche basé sur la bibliothèque numérique Gallica développée par la Bibliothèque nationale de France) et de ses partenaires, offrant ainsi une ressource précieuse pour les passionnés de sport et les chercheurs.
Stadium est la première bibliothèque numérique de valorisation du patrimoine sportif. Elle rejoint le programme « Gallica marque blanche » proposé par la BnF.
Sources
- Stadium : https://stadium.museedusport.fr/stadium/
- Plan héritage et durabilité : https://medias.paris2024.org/uploads/2021/09/Paris2024-210830-Legacy-Plan-FR.pdf
- Musée National du Sport (Nice) : https://www.museedusport.fr
Réseaux et médias sociaux
- X : @MuseeduSport